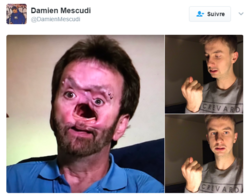-
Par Cinnamon Fraise le 12 Mars 2020 à 00:13
Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque comportement déviant, si minuscule qu'il soit, a des conséquences dramatiques.
Moi, j'ai mis 30 ans avant d'en parler. Et après j'ai mis du temps à me sentir victime. Parce que l'épicier, il ne m'a jamais "touchée". Jamais aucun contact charnel. Il se contentait de frotter, habillé, sa queue en érection contre mes fesses de petite fille habillée de 8 ans, chaque fois que j'allais acheter des bonbons dans son magasin. Si j'ai mis aussi longtemps à en parler, c'est parce que je n'ai pas compris la gravité de ce comportement. Et si j'ai mis du temps à me sentir victime, c'est parce que je me comparais à celles qui ont vécu pire.
Pourtant, ces frottements ont eu un impact dramatique sur ma vie. Ce comportement sexuel a stoppé net mon enfance, et je suis devenue sans m'en rendre compte une femme. À 8 ans. Une femme qui ne connaît que la séduction dans son rapport aux hommes. Une femme qui ne peut envisager que les hommes ne s'intéressent pas à elle. Une femme qui ne sait pas qu'on n'est pas obligée de dire oui à tous ceux qu'elle intéresse. Je sais que ça ne s'est jamais vu. Je n'étais et n'ai jamais été une mante religieuse, hein. Je n'ai même jamais su draguer, une fois adulte. Mais dans ma tête c'était plié : tous les hommes doivent tomber sous mon charme.
Parce que ce comportement déviant, ça conditionne. Et j'ai envie de dire, surtout quand il n'y a ni violence ni pénétration. Ça s'insinue en douceur à l'intérieur, on sait bien que c'est pas normal mais c'est pas si grave, on se construit avec ça.
Et puis quand on cesse d'acheter des bonbons la vie continue. On grandit. Les premiers flirts arrivent. On morfle un peu plus que la normale quand un crush se refuse à nous, et on tombe dans les bras de tous ceux qui veulent bien de nous. Malgré tout ça, un jour on trouve sa place auprès de celui avec qui on fait un enfant, on se marie, parce que la vie est belle. On continue d'avancer avec ce secret auquel on ne pense presque jamais. La maman fait taire un peu la femme, c'est reposant.
Et puis un jour la femme sort de sa cachette, un peu comme le diable sort de sa boîte, et part en vrille. S'éparpille. Cherche un moyen d'exister dans une vie qui n'est pas faite pour elle. Infidèle donc menteuse, elle s'invente une vie qu'elle n'aimerait même pas vraiment vivre. Elle se trouve des excuses, cherche des explications, trouve des justifications à son comportement. Sans pour autant rien n'y comprendre. Toujours dévastée par le refus de ceux qu'elle brigue, toujours partante pour suivre ceux qui veulent bien d'elle. Jusqu'au jour où un psy tente de lui expliquer que tout ça, c'est de la faute de l'épicier. Qu'elle n'est ni une pute ni une salope, mais une victime. Ah, et puis son surpoids aussi ça vient de là. Réfléchis, tu mangeais rien avant tes 8 ans et soudain t'es devenue gourmande...
Oui mais je ne suis pas vraiment une victime moi, il n'a jamais été violent, ne m'a jamais touchée de ses mains...
3 ans. Il m'a fallu 3 ans pour arriver à intégrer que si, ce gros connard avait brisé ma vie. Qu'à cause de lui je suis anxieuse, stressée et angoissée. Qu'à cause de lui il y a 18 mois j'ai ajouté un stress post-traumatique à retardement à mon burn out. Que je suis dépressive depuis mes 8 ans. Que je me suis faite prendre par des mecs dont je n'avais aucune envie parce que je croyais que c'était normal. À cause de lui que j'ai fait souffrir mon ex mari, un homme merveilleux. Que mon fils vit avec des parents séparés. Que sa mère est au 36ème dessous tous les quatres matins, faisant tout pour le lui cacher. À cause de lui que je lutte si souvent contre l'envie d'en finir.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque geste compte. Du plus petit effleurement volontaire à la pire des violences. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque silence tue un peu plus. Chaque doute, chaque moquerie enfonce un peu plus les victimes dans leur détresse. Les agresseurs DOIVENT être montrés du doigt. Jugés. Plus ils le seront, plus les suivants auront peur et réfléchiront peut être à deux fois avant d'agir. Ils ne DOIVENT PAS être protégés. Ces comportements, quelle que soit l'époque et la conscience du bien et du mal qui n'a pas toujours été la même, DOIVENT être Condamnés. LES CHOSES DOIVENT CHANGER. Parce que ces comportements BRISENT DES VIES.
(Notez que je parle de condamner les comportements et non leurs responsables, parce que pour moi ces gens n'ont pas leur place en prison. Ce sont des malades qui ont besoin d'être soignés. Les mettre en prison à mon sens revient à mettre en quarantaine un tuberculeux sans le soigner)
Il est important que les victimes se sentent LÉGITIMES, et à l'aise d'en parler. Il est important qu'on les ÉCOUTE et que les plaintes ABOUTISSENT. Et que les responsables ne restent PAS en liberté, avec d'innombrables possibilités de recommencer.
NB : Je rassure les inquiets(es) et freine tout de suite les morts de faim, mon rapport aux hommes est "normal" depuis environ 2 ans. Merci.
L'épicier, j'en reparle ici : Qui était-ce ? , et là : C'était...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 3 Mars 2017 à 19:10
Je pense foncièrement que le fait d'avoir laissé faire et dire certaines choses, certaines plaisanteries, depuis longtemps, a contribué à "l'écrasement" de la femme. Les petites blagues dites sexistes.
-C’te meuf c’est tellement une bombe qu’elle fait concurrence à Daesh. J’lui planterais bien mon missile ! *yeux rivés sur le décolleté*
-Vise moi cette carrosserie… Sacrés pare-chocs la gonz, j’vais lui casser son train arrière *sourire pervers mais pas trop*
Ainsi que les petites piques homophobes qui amusent encore probablement, et pas que ceux de #LMPT.
-Tiens, t’as mis ta chemise de pédé aujourd’hui ? Ben oui, le rose, c’est pour les pédés ! *rire gras*
-Vazy tu’m’fais pas la bise j’suis pas un pédé moi ! *check viril*
Tout comme les blagues sur les Bamboula et autres Salomon ont bien évidemment aidé à développer une forme de racisme.
-Qui m’a piqué mon agrafeuse ? Hey Momo fais voir tes poches espèce de voleur *regards complices*
-On va boire un coup ce soir ? Et David, tu nous fais pas le coup du portefeuille oublié hein ! Ouais ouais ouais… On sait comment vous êtes, les juifs… *fou rire général*
Sans oublier les moqueries « régionales » à propos de la consanguinité, la débilité, les accents… Les vannes sur les gros, ET LES PORTUGAIS QUI NE SAVENT QUE CONSTRUIRE DES MURS ! Et tandis que beaucoup d’handicapés se battent pour qu’on continue à se foutre de leur gueule, pour se sentir enfin un peu comme tout le monde….
Oui, tout ça a obligatoirement aidé à certaines déviances. Tout ça nous a amené à avoir peur des autres, plus que de raison. Tout ça nous a menés à une autocensure radicale, à une censure outrancière, à des levées de boucliers ridicules. Et à des flots de récupération. Les frustrés en profitent pour se venger, les médias et assimilés pour essayer de faire le buzz. Et puis il y a tous ceux qui parlent au nom des autres. Demandons d’abord aux noirs, arabes, handicapés et autres « minorités visibles » (j’ai vomi un peu en écrivant cette expression, pardon) ce qu’ils en pensent. Pour mémoire, ce sont des gens « normaux » qui ont fait un procès à Patrick Timsit, pas les trisomiques (je vous vois venir, les adeptes du #LundiNoLimit, avec votre ‘’Pour ça il faut un cerveau en bon état LOL’’) (et je vous applaudis des deux mains) (oui parce que moi j’en ai deux, pas comme Philippe Croizon) (MAIS ARRÊTEZ MOI BORDEL).
Bref. Vous avez compris ce que je voulais dire.Mais tout ça, ça doit continuer d'exister. On doit pouvoir continuer à être misogyne, raciste, irrespectueux, premier degré, à condition que ce soit de l'humour. On ne doit pas apprendre à nos enfants à se taire, mais à discerner. Le bien du mal, l'humour de la méchanceté, la fiction de la réalité. On doit leur apprendre que les mots ont un sens, un double, un contre, un SENS. De l'humour.
Et bien sûr, on doit pouvoir se reposer sur la justice de notre pays pour que ceux qui seraient coupables d’actes ou de paroles RÉELLEMENT racistes, misogynes, insultants soient punis comme il se doit.
Réfléchissez avant de vous offusquer. Si ce monde va trop vite, sommes nous vraiment obligé de le suivre ?
Pour conclure, quelques pépites de tweets illustrant mon propos. Les gens y figurant ne sont ni racistes, ni misogynes, ni méchants. Ils plaisantent. On a le droit de les trouver drôles, ou pas. Mais on n’a pas le droit de donner un sens erroné à leurs propos.
(et si vous les trouvez drôles, je vous conseille le #LundiNoLimit et la sélection #IlEstOùLeRespect par @Eve_undivided chez @TheTlers pour en trouver d'autres)
Et bon vent à la #TeamPremierDegré o/
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas- 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 13 Septembre 2016 à 10:54
En effet, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. Parce que l'homme ne crache jamais sur un rapport sexuel.
Après il y a les cons, qui trouvent normal d’assouvir leurs pulsions n'importe quand et avec n'importe qui, même s’il y a refus. Parce qu’on ne refuse pas, lui a toujours envie alors pourquoi les femmes seraient différentes ? En plus elles veulent être leurs égales, il faut donc qu’elles se comportent comme eux.
Alors non, être égaux ne veux pas dire être identiques. Être égaux ne veut pas dire se comporter de la même manière, ou subir le comportement de l’autre. Être égaux ça veut juste dire bénéficier des mêmes libertés, des mêmes droits. Des mêmes DROITS. Une femme, comme un homme, un enfant, a le droit de ne pas vouloir. Ne pas vouloir manger, ne pas vouloir marcher, ne pas vouloir dormir, lire, boire, faire le ménage, mettre des chaussures, chanter, que sais-je encore, et donc elle a aussi le DROIT de ne pas vouloir baiser. Et le fait que l’homme en ait envie ne change rien, ça devrait être une évidence. Parce que l’homme, lui, comme la femme, a le DEVOIR de se raisonner. De savoir se tenir. De ne pas marcher sur les pieds de quelqu’un pour lui passer devant. De ne pas se servir dans l’assiette du voisin sans demander juste parce qu’il a faim. De ne pas voler une boisson sur un étal juste parce qu’il a soif. Bref, de respecter ceux qui vivent autour quoi. Et de respecter les lois.
Le seul qui a légalement le droit de forcer une femme à faire l’amour, c’est son époux. Parce que oui, aussi énorme que cela puisse paraître, et c’est peut-être aussi de là que vient le problème, légalement faire l’amour est un devoir. Donc une obligation.
Alors messieurs les cons sans cerveau :
1/ ça n’est pas valable pour les femmes dont vous n’êtes pas l’époux
2/ il serait peut-être temps de faire disparaître cet article de loi non ? Hein, messieurs les polit… Ah ben non, zut, c’est vrai que ce sont ceux là même qui harcèlent sexuellement les femmes qui sont décideurs de ce genre de choses… Oups.
Faisons alors appel au bon sens, comme pour l’interdiction de porter un pantalon pour les femmes, loi restée en vigueur jusqu’en 2013 (ET OUI). Pourtant tout le monde s’accordait à dire qu’elle était obsolète et personne n’y prêtait cas. Non ? Ah ben non, parce que le pantalon on s’en fout, pour baiser on peut l’enlever. En gros.
Tout ça pour dire que malheureusement non, les êtres humains ne seront jamais égaux. Parce qu’ils ne naissent pas avec le même cerveau, et ne sont pas toujours éduqués dans le respect des autres. Y’a encore du boulot.
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas- 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 27 Avril 2016 à 12:41
....Autre réponse possible à la question posée dans -Qui était-ce ?
Qui était-ce ? Mais un connard, bien sûr. Un sale connard qui a gâché ma vie.
J’ai vite compris les conséquences de ce qu’il a fait sur mon rapport aux hommes. Ça ne m’a pas vraiment remuée, j’ai pensé que j’allais juste devoir vivre avec, que je changerai sûrement un peu et puis basta. Parce que c’était logique. Évident à comprendre. Comme dirait l’autre, ça m’en a presque touché une sans faire bouger l’autre.
Et puis soudain, la colère assourdissante. A la minute où je réalise que les conséquences sont ailleurs aussi, que ce connard a fait naître en moi un genre de passager noir que je traîne depuis comme un boulet. Cette mélancolie latente dont je n’arrive pas à me débarrasser et dont je ne connaissais pas l’origine. Ce passager noir, qui s’est interposé tant de fois entre les autres et moi. Parce qu’incompris, il a été rejeté par certains, ignoré par d’autres, et inévitablement enfoui par moi. Cette incompréhension et cette ignorance qui ont créé un manque de soutien, de compassion, de tendresse pour cette sombre partie de moi. Ce coin de ténèbres dans lequel se cachent la petite fille effrayée par des monstres invisibles, la femme blessée par des épées fantômes, l’enfant qui a toujours voulu être adulte, l’adulte qui refuse de grandir… Sans rien comprendre au pourquoi du comment. Se disant que tout ça est normal, qu’il y a tant de gens autour qui sont perdus aussi et qui avancent quand même. Alors ce coin de ténèbres, je l’ai gardé fermé à clé. Enfin, comme j’ai pu. Parce qu’il est costaud, et qu’il a déjà réussi à entrouvrir la fenêtre pour s’insinuer dans les histoires inventées par mon cerveau. Les histoires qui n’ont jamais de Happy End, celles qui reflètent la quête d’un bonheur incessamment contrée par un inévitable malheur. L’inconscient qui s’exprime à travers les fictions. J’ai toujours cru que c’était une question de goût, j’aime Baudelaire et les histoires sombres, fan de hard-rock je kiffe forcément les têtes de mort et aussi une esthétique pseudo-gothique, tout s’explique toujours. Alors écrire des histoires qui finissent mal, ça va forcément avec. Sauf que non, bien sûr. Mes histoires qui finissent mal, c’est mon passager noir qui les écrit.
Ce passager noir, ombre d’un épicier sans scrupules, a bouffé mes tripes pour y laisser une sensibilité émotionnelle trop souvent inexpliquée. Trop souvent incomprise, et trop souvent piétinée. Même si certains, parfois, ont eu la générosité de l’accepter, elle n’a jamais vraiment pu s’exprimer au grand jour. Parce qu’un mal qui n’a pas de raison n’existe pas.
La conclusion de tout ça, c’est que même si on sait de quoi on est fait, on ne sait pas toujours d’où ça vient. Et quand on a trouvé, il faut arriver à avancer en apprivoisant la tentation de changer du tout au tout parce qu’on a beau ne pas avoir choisi ce qu’on est devenu, c’est malgré tout ce qu’on est. La vie ne sera plus jamais comme avant. En partie. Parce que refaire toute la déco serait trop dépaysant.
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas-
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 14 Avril 2016 à 14:49
Sally se réveille ce matin la gueule enfarinée. Elle est perdue. Elle sait qu’elle a un fils, un mari, un boulot, des amis. Et pourtant elle est perdue. Faut dire aussi qu’elle a vécu plusieurs vies, ces derniers temps, Sally. Elle a pris des chemins de traverse, des chemins caillouteux qui lui ont écorché les genoux, des épineux qui lui ont laissé des griffures, des glissants qui l’ont parfois faite chuter. Elle a sauté dans le vide, fait machine arrière, tourné en rond, puis est revenue au point de départ. Et malgré tout elle est perdue. Elle jette un œil au porte-clés histoire de faire un ultime point… Bon. La grille du chemin caillouteux, elle l’a fermée à double tour. Hors de question de laisser à nouveau ses genoux se faire écorcher. La porte en bois du chemin épineux aussi, bien fermée. C’est sûr qu’elle n’y remettra jamais les pieds. Elle y a déchiré sa jupe préférée, les ronces lui en ont fait trop voir, alors terminé. Le cadenas qui condamne la promenade le long du ruisseau aussi, un bon tour de clé. Trop dangereux. La mousse sur les galets super glissants, le passage trop étroit pour sa silhouette généreuse, non non non ça aussi c’est fini.
Voilà. De bonnes choses de faites. Mais n’empêche que Sally, ce matin, se réveille la gueule enfarinée. Sally c’est le genre de nana qui n’a pas de limites, voyez. Elle y va toujours à fond. Quitte à se brûler les ailes, d’ailleurs. Tant pis. Même s’il n’y a pas d’issue, ou qu’elle est fatale, elle prend tout ce qu’elle peut en attendant. Même si elle a longtemps cru qu’elle donnait, Sally. Elle en a parlé un jour (ici). Elle a longtemps cru qu’elle donnait, et puis au final elle se rend compte que surtout elle prenait beaucoup. Elle a été une mère plus que présente, une épouse (parfois bancale), une amie (un peu comme elle a pu), et tous ces gens à qui elle pensait donner à outrance, en fait, elle leur prenait leur affection. Se nourrissait de leur présence. S’abreuvait de leurs rires, de leur tendresse, de leur amour, et de ce que ça provoquait chez elle. Pas grave si ça dure pas, tant que c’est là faut prendre. Finir le plat sans penser au mal de ventre qui suivra. Bon, ok, quand vient le mal de ventre Sally elle se trouve bien conne, hein. Et puis elle a bien mal aussi. Mais elle est comme ça.
Sally, c’est une artiste. Ça aussi elle en a parlé (là). Les artistes donnent à leur public mais pour se nourrir de l’amour porté en retour. Ben quelque part, Sally, dans la vie, elle est comme ça. Et comme tous les artistes qui se sentent terriblement seuls une fois le concert fini, en peignoir dans leur loge ou chambre d’hôtel, ben Sally se sent seule et perdue. Et se rend compte, à cette période charnière de sa vie, qu’elle n’a jamais appris à vivre seule. A vivre pour elle. A vivre face à elle. Elle, qu’elle ne connait pas si bien que ça. Elle pour qui elle n’a finalement que peu de respect et de considération. Elle qu’elle aurait voulu autre. Autrement. Sally, dont la vie a été si bien remplie, a fait ce qu’elle a pu pour être tout ce qu’elle a été. La seule chose qu’elle n’a jamais su être, Sally, c’est elle.
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas-
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 19 Novembre 2015 à 13:18
On a tous nos bagages, dans la vie. Nos valises, nos casseroles, nos fardeaux. Parfois on se dit que si un professionnel mettait un peu son nez dedans ça ferait du bien, un genre de ménage, on ouvre grand les fenêtres, on aère et on respire. Et puis la vie continue, tout le monde a ses problèmes, on avance quand même avec et c’est pas si grave. Jusqu’au jour où ta vie de famille vole en éclats et que tu toques à une porte pour y trouver de l’aide. Ce jour-là le psy t’isole, te regarde droit dans les yeux et te pose LA question sur ce qui a peut-être déterminé toute ta vie :
-Qui était-ce ?
-Hein ? Qui ça ?
-Celui qui a abusé de vous.
Alors soudain (parce qu’évidemment ça tu ne l’avais jamais dit à personne) des larmes vieilles de plus de trente ans sortent sans prévenir. Alors que non, c’était pas si grave, il n’a même jamais ouvert son pantalon l’épicier, il se frottait juste un peu comme ça, c’est pas si grave…
Si, c’est grave. J’étais une enfant. Il n’avait pas le droit et je le savais. IL. N’AVAIT. PAS. LE DROIT.
Du coup tu réfléchis. Tu refais ta vie, tu te demandes ce qui serait différent ou non si tu n’avais pas vécu –pardon, subi ça. Est-ce que ta vie serait différente. Est-ce que TU serais différente. Est-ce que tu serais malgré tout devenue celle que tu es, est-ce que tu aurais quand même fait ce que tu as fait. Est-ce que. Evidemment, depuis, tu creuses. Une heure une fois par semaine. Comme des milliers de gens. Avec cette impatience d’en apprendre plus, cette boulimie d’informations qui chaque fois te bouleversent et te vrillent un peu plus. Avec le quotidien à vivre, à affronter. Avec chaque fois le sentiment d’être de moins en moins toi, le sentiment de sortir de ton âme, le sentiment de mourir à petit feu. Une petite mort, comme une injection d’héroïne, le sourire de bien être alors que le poison s’infiltre. Chaque jour qui passe laissant une trace, comme la seringue laisse une marque de piqûre. Chaque larme creusant son sillon, salé, piquant les plaies qui en résultent. Chaque mot cognant un peu plus fort, laissant des bleus invisibles. Et chaque envie d’avancer, coupée dans son élan par l’envie de mourir qui balance des croche-pieds à la pelle.
Chaque seconde devenant l'attente interminable de savoir ce que tu vas devenir si celle que tu as toujours été n’est pas toi.
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas-
 8 commentaires
8 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 16 Novembre 2015 à 14:00
« Salut, ça va ? T'as passé un bon week-end ? »
Que répondre après ça ? Que penser d’un « oui », d’un « non » ? Dire oui si c’est non, parce que nos petits tracas font bien pâle figure face aux évènements ? Dire non même si c’est oui pour montrer qu’on compatit ? Que dire après ça ?
Comment vivre avec sa vie après ça ? Comment ne pas culpabiliser qu’un tel évènement n’arrive pas à balayer nos soucis quotidiens ? Comment ne pas avoir envie d’en finir parce que déjà que sa propre vie est un beau merdier, si en plus le monde en face ne laisse que peu d’espoir de sourire alors à quoi bon…
Que penser de l’agacement ressenti à propos des discussions sur le sujet autour de la machine à café ? Comment ne pas culpabiliser de penser qu’ils devraient tous fermer leur gueule au lieu de dire des conneries ? Comment ne pas se retenir de les envoyer chier alors que c’est comme ça que beaucoup expient leurs angoissent, leurs peurs, leur chagrin…
Comment vivre après ça, en plein Marseille notamment, où l’on croise parfois presque plus de gens d’origine maghrébine qu’au Maghreb (ironie) ? Comment ne pas avoir peur, comment éviter l’amalgame, comment assumer cette peur sans qu’elle soit interprétée justement comme un amalgame et ne blesse des innocents ?
Comment ne pas froncer les sourcils quand une colonie de sirènes, police ou pompiers, retentit soudain dehors ? Comment s’empêcher d’aller voir à la fenêtre, comment éviter la recherche Google dans l’heure qui suit, comment ne pas trembler même à 850 kms des lieux visés ?
Comment. Pourquoi.
Parce que les enfants, parce que les larmes, parce que les bougies. Parce que les gens, ensemble, envers et contre tout. Parce que malgré le désespoir, la fatigue et le ras-le-bol, il ne faut pas les laisser gagner. Parce que ce monde est pourri, mais que ce n’est pas une raison. Parce que tant qu’il y aura une âme, même une seule sur cette terre, qui ne comprend pas ces actes, il faudra rester debout. Sur ses deux jambes, ses béquilles, ses talons de douze, ses prothèses, appuyé sur l’épaule de l’autre à côté, mais rester debout. La tête haute. La tête haute et le regard franc, la conscience de la mort dans un coin du cerveau, le cœur gonflé de désespoir enragé. « Soldats » éphémères ( <- c’est l’espoir qui m’a dit d’employer ce mot), notre vie devient un champ de bataille. Notre quotidien un combat de fierté, la fraternité, la solidarité et la tolérance nos armes éternelles.
«Au nom de quoi ? » a écrit quelqu’un sur une vitrine criblée de balles. On ne saura jamais au nom de quoi on peut tuer des innocents, mais on saura toujours au nom de quoi on ne le fait pas.
-Et si vous souhaitez suivre mes mots, il y a la newsletter. N'hésitez pas-
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 28 Janvier 2015 à 10:16
Je sais quels sont mes défauts, je sais l’image que je renvoie. Parfois j’arrive à lutter, à donner le change, à garder la tête hors de l’eau. Et puis parfois je n’y arrive plus, et alors mes efforts commencent à sonner faux.
Il y a les moments où je me donne sans compter, ceux où je me nourris du plaisir que j’offre aux autres, où la générosité devient ma raison de vivre. Que je le souhaite ou non. Et puis il y a ces moments où je m’effondre. Où, paniquée, je ne vois plus rien d’autre que ma propre douleur. Mon propre tourment. Et où je commence à inonder les autres de moi, à ignorer leur eux, frontalement, ouvertement, sans aucune retenue. Mais toujours inconsciemment. Jusqu’à ce que, justement, j’en prenne conscience. Alors c’est la honte et la culpabilité qui m’envahissent, l’envie de fuir, j’attrape toutes les couvertures et les plaids que je trouve et je m’enterre dessous bien profond. Je me coupe des autres, peut-être pensent-ils que je me désintéresse d’eux, mais c’est juste une culpabilité mal placée et une pudeur maladroite qui prennent les commandes. Je sais que je perds des gens à ce petit jeu, mais je sais aussi que certains, même s’ils observent aussi à ce moment-là un mouvement de recul, seront toujours là. Malgré mes maladresses, malgré mes hésitations à revenir, malgré même parfois mon incapacité à revenir. Cette incapacité qui me paralyse, qui m’empêche de parler, d’être détendue dans l’approche de l’autre, et qui souvent brouille les pistes. Faisant croire encore une fois que je me désintéresse ou que j’ai tourné la page, alors que le manque me ronge.
A ce moment de ma vie où se présente à moi une sorte de bilan, de découverte de moi-même, de redécouverte d’un moi oublié depuis trop longtemps, je dois apprendre à revenir quand je pars. Ou à ne pas partir, l’idéal. Pour ça je dois savoir être moi-même, m’accepter comme je suis et m’imposer. Avec parcimonie. M’imposer, moi, dont on dit que j’ai une forte personnalité. Forte peut-être, envahissante sûrement, ébréchée certainement. Plus ébréchée encore en en prenant conscience.
Je dois apprendre à être plus frontale pour paraitre moins hypocrite, plus franche pour moins me forcer, (m’)avouer que je risque d’oublier l’autre pour moins souffrir de le délaisser. Comme je sais si bien faire. Les efforts, s’ils se voient, deviennent inutiles. Savoir doser, savoir dire, savoir être. Ne pas se laisser envahir par l’euphorie, la douleur, l’émoi que provoque l’autre en face. Apprendre la détente.
Se comprendre soi-même, la quête de toute une vie. Digérer les autres et les émotions qu’ils nous apportent, nous infligent parfois, un combat quotidien et démesuré. Infini.
« J’ai laissé des bouts de moi au creux de chaque endroit. Un peu de chair à chaque empreinte de mes pas. Des visages et des voix qui ne me quittent pas, autant de coups au cœur et qui tuent chaque fois. »
-Jean-Jacques Goldman
L’idée, c’est de savoir (r)assembler ces bouts pour arriver enfin à être soi en toute sérénité.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 8 Novembre 2014 à 19:35
Ce monde me casse les burnes. Pas celles dans lesquelles la majorité a inséré un bulletin permettant d’élire celui à qui elle en met plein la gueule, non, celles-là il leur manque le « b » de couilles justement. Les burnes, disais-je, celles que je n’ai pas et pourtant que certains hommes ici bas ont moins que moi. (Si vous voulez prendre un Doliprane c’est maintenant, je ne garantis pas que la suite soit plus compréhensible.)
Ce monde me casse les burnes, donc, à force d’incohérences et de violences, de manque d’amour et de partage, d’illogisme et d’abandon. D’abandon du bien-être -au siècle de l’explosion des SPA, mais ne vous leurrez pas tout ceci n’est que poudre aux yeux- de la personne, des familles, de pseudo considération de l’individu et de sa vie privée, ses conditions de travail et tout le tralala. Les aberrations entrent dans les mœurs de plus en plus rapidement, faisant passer la plus petite réflexion sur un quotidien dévasté pour un coup de gueule de rebelle de la société. Trouvez-vous acceptable, vous, que les gens soient obligés de se déraciner pour travailler ? Trouvez-vous acceptable que les pubs relaient cela en nous montrant des pères et des mères fêtant l’anniversaire de leurs enfants à travers un écran de smartphone ? Trouvez-vous acceptable que le monde du travail soit devenu tellement une priorité que plus rien n’a d’importance à côté ? Est-ce devenu la vocation de l’être humain, que d’avancer sous les coups de fouet et surtout de bien bien fermer sa gueule ?
Parce qu’il ne me semble pas qu’un être vivant, surtout doté d’intelligence, soit voué à délaisser la vie au profit d’argent qui lui sert à payer ce qui lui sert à travailler qui lui sert à payer ce qui lui sert à travailler qui lui sert à payer ce qui lui sert à travailler merci au serpent qui se mord la queue. Et avec ça, quand on a le malheur de rechigner, et encore je ne parle pas des grévistes qui font chier tout le monde, certains (voire tous) balancent bien gentiment : «Oh, on n’est pas si malheureux, pense à ceux qui n’ont rien et qui meurent de faim »
Bon. Ok. Je pense à eux. Et alors ? Est-ce que ça améliore mon quotidien ? Non. Ca, cher ami, ça s’appelle tirer les gens vers le bas. Tant qu’on y est, allons tous vivre dans la rue, faire les poubelles et se laver dans le caniveau puisque c’est le quotidien des pauvres SDF. On a du mal à grimper, certes, mais est-ce une raison pour descendre ? Doit-on subir parce qu’il y a pire ? (Je fais des rimes sans le vouloir, merci d’applaudir mon talent.)
Je sais bien que mon coup de gueule est un coup d’épée dans l’eau. Mais j’ai l’espoir secret (même s’il est vain) de ne pas être la seule, qu’à force on éclaboussera un peu les cerveaux trop secs, voire même en poussant loin on noiera la connerie. Hé, mec, t’as une vie, des gens que tu aimes, qui t’aiment, des passions et des envies, alors cesse de perdre ton temps à courir après un salaire et/ou un quotidien insipide sans but. Si on se met tous à vivre, je vous jure, ils ne pourront plus rien contre nous.
Dixit la nana qui vit dans un HLM parce qu’elle a un boulot alimentaire de merde qui ne lui permet pas d’avoir plus, et qui rêve d’autre chose depuis le sommet de sa tour. Mais qui tremble chaque jour sous les émotions, se fait peur tellement elle vit ses passions, et a bien conscience que tout ce qu’elle vient de dire n’est pas simple à réaliser puisqu’au fond, on est tous pieds et poings liés.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 20 Octobre 2014 à 15:01
Faire le point sur sa vie. S’interroger sur ce que l’on est, ce que l’on a été, ce que l’on veut, ce dont on a envie. Ce qu’on ne veut plus, ce qu’on regrette, ce qu’on espère. Faire des choix. Savoir que ces choix vont engendrer de la souffrance, chez les autres ou pour soi-même, se demander comment sera l’avenir, s’il va ressembler au présent, au passé, si les choses qui ont changé resteront. Se demander où est sa place, quelle est celle que l’on accorde aux autres, qu’on veut bien leur accorder, qu’ils accepteront. Se sentir bien dans une situation qui ne convient pas à tout le monde.
Ne pas savoir dire les choses qu’il faut quand il faut, brouiller les pistes par peur ou ignorance, avoir ses propres pistes brouillées par l’attitude ou les mots de l’autre. Se demander si l’on a vraiment été soi avant, si on le sera pour toujours, quels sont les facteurs qui entrent en jeu en cas de changement. Quelles sont les choses à garder en cas de choix, quels sont les choix qui seront les plus judicieux, qui feront le moins souffrir. Se rendre compte avec tout ça que l’on devient adulte, qu’on ne sait pas comment faire, qu’on a l’impression qu’on ne le sera jamais. Réaliser que l’on est resté un enfant dans sa tête, et que comme les enfants quand on a peur on fuit, on court se réfugier sous le lit, derrière le rideau, au fond du placard en prenant bien soin de fermer la porte. On attend, tremblant, qu’un sauveur vienne nous prendre doucement la main, nous caresser le front et nous dire que tout va aller bien désormais, que les méchants sont partis.
Sauf que l’on ne peut s’empêcher de penser que c’est nous, les méchants, qu’on fait du mal, qu’on déroute, qu’on brouille les pistes et les yeux des autres. Qu’on interrompe leur vie paisible avec nos conneries, qu’ils n’ont rien demandé et qu’ils se portaient très bien avant qu’on remue la vase stagnante au fond du lac au calme plat. Et malgré tout ça on est pris dans l’engrenage, dans l’avalanche de la vie qui nous entraine sans trouver aucune branche à laquelle s’accrocher. Sans pouvoir crier au secours, de toute façon il est trop tard, il va falloir attendre que ce soit fini pour constater l’étendue des dégâts.
Pendant ce temps l’instinct de survie fait son boulot, nous on se met en position de repli pour éviter trop de commotions, trop de chocs avec les rochers ou les arbres qui trainent sur le chemin. Les autres autour trouvent forcément ça égoïste, mais dans la chute on ne peut rien faire d’autre et c’est en arrivant un minimum sain et sauf en bas qu’on pourra aider les blessés. Espérer qu’on saura soigner, ou du moins atténuer les douleurs. C’est pas facile, ça dépend de nous, pas toujours parfois, ce sont les embûches qui empêchent d’avancer correctement. Mais il faut se sauver soi-même avant de sauver les autres. Il faut trouver son point d’équilibre. Point, à la ligne.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 3 Octobre 2014 à 14:42
Vivre. Grandir. Mûrir. Apprendre. Tomber. Aimer. Se relever. Comprendre. Penser. Dire. Demander. Attendre. Oublier. S’attendre à. Tromper, se tromper. Mentir ou se dévoiler. Parler, se taire, avancer, tournoyer. Se noyer. Respirer. Regarder, chercher, trouver, recommencer. Trembler. Se trouver. Se rechercher. Contrer. Divaguer. Perdre. Gagner, peut-être. Créer. Envier. Avoir et vouloir. Reculer et se réfugier. Crever. Avant de mourir. Revivre toujours, malgré soi parfois. Donner. Redonner. Prendre. Voler. Coaguler. Toucher, sentir, écouter. Goûter. Vomir. Voir. Avaler. Digérer. Maltraiter. Cogner. Massacrer. Encaisser. Caresser. Jouir. Suer. En suer. En chier. Aider, céder, se donner. Enfermer. S’ouvrir aux autres, s’ouvrir les veines. Souffrir. Commencer pour en finir. Finir d’arrêter. S’arrêter enfin. Répondre. Se répandre. Se pendre. Assumer, enjamber, croiser, sauter. Dans le vide. Le pas. Foudroyer, marteler, arracher. Panser. Se dépenser. Hurler. Chanter. Pleurer. Courir. Déchirer. S’étouffer. Priser. Débrancher. Manipuler, accepter, repousser. Rêver. Veiller. Dormir. Soigner. Passer, simplement. Être en vie. Être en vue. Être vu. Être. Humain, fragile, planté, défaillant, le plus fort. Être. A l’envers, à l’endroit, plus que tout. Être tout et rien. Être, soi. Soit. Soyons.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 30 Juillet 2014 à 09:42
Vide. Vide à l’intérieur et pourtant en ébullition. Les entrailles qui se déchirent, la gorge douloureuse à force de retenir une boule trop grosse pour elle. Vide. Les coins de la bouche qui tombent sans plus avoir la force de se relever. Vide.
Vide et sans nulle part où aller. Le crâne dans un étau, jambes flageolantes et mains tremblantes. Regardant l’horizon en n’imaginant rien d’autre qu’un vide aussi grand que le mien derrière. Regardant les étoiles se changer en simples points blancs dans le ciel, perdant chaque jour un peu plus de leur scintillement. Et le vide. Tout autour.
Le vide, sans nulle part où aller. Errant au sol, les bras ballants, privée de mes ailes douloureusement arrachées. Privée de mes rêves d’enfant qui nourrissaient mes espoirs de grande fille. Regardant le soleil et ne sentant que la douleur de sa brûlure sur ma peau, que les entailles de ses rayons lacérant mes yeux. Vide, et sans nulle part où aller. Remplie de larmes sans saveur. Envahie de visions sans couleur, privée des battements de mon cœur. Avançant sur un chemin sans balise, guettant les obstacles qui me feront trébucher.
Vide, vidée, lacérée à l’intérieur. Mon sang s’écoulant en dedans, noyant mes pensées engluées dans le liquide chaud et poisseux. Dans le poison qui m’envahit, cette hémorragie de moi s’écoulant par les pores de ma peau fatiguée. Chaque pas m’enfonçant un peu plus dans le sol, retardant mon avancée vers la lumière et accélérant ma descente aux enfers.
Vide, sans nulle part où aller. Butant contre les murs, rajoutant des bleus à mon âme déchirée d’avoir trop voulu vivre. Des coups à mon cœur tuméfié d’avoir trop voulu aimer. Des maux à mes bras épuisés d’avoir trop voulu donner. Vide, sans nulle part où aller.
Excepté le vide dans lequel je m’enfonce toujours un peu plus, tentant de m’endormir pour oublier… le vide.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 21 Juin 2014 à 17:01
C’est une femme. Elle est libre, forte, faible un peu, elle aime la vie et rire de tout. Elle a des responsabilités qui lui creusent la ride du lion, elle est féminine et pourtant sent bien la paire de couilles qui lui pend entre les jambes. Elle aime les gens, parfois trop se dit-elle, mais c’est tellement bon malgré le mal que ça peut faire.
Et pourtant, c’est une connasse égoïste. Une connasse égoïste qui souvent parle tellement trop d’elle que les autres n’ont pas la place de parler d’eux.
Qui fréquemment délaisse le plus important pour se consacrer à des futilités.
Qui voudrait avoir plusieurs vies, un homme pour chacune d’elles, et rien à faire dedans.
À qui au boulot il arrive de faire semblant de bosser tellement c’est passionnant.
Qui refuse toujours de se livrer à certaines activités qui feraient pourtant bien plaisir à celui qui les partagerait.
À qui il arrive aussi de se fermer, pour ne plus rien entendre, ne plus rien voir, souhaitant que certaines choses s’effacent pour tout recommencer. Oublier les bêtises et les douleurs, les maux et certains mots.
Qui souvent prie fort pour se retrouver seule et pouvoir enfin être elle, sans comptes à rendre et sans façade à ravaler.
Qui n’ose pas pleurer devant les autres, parce qu’elle ne sait pas se livrer.
Qui parfois malgré tout se livre, s’offre, prend sans donner en retour et crée un manque chez l’autre en face.
À qui il arrive de se laisser distraire, coupant l’élan de celui qui venait se confier.
Qui joue les schizophrènes et cache son autre moi à plein de gens.
Qui ferme sa gueule et sourit, accumulant les contrariétés et te les faisant exploser à la gueule quand y’en a trop, sans que tu saches d’où ça tombe.
À qui il arrive de faire semblant de ne pas voir pour ne pas dire.
Qui se dit qu’elle n’appartient à personne, quelle que soit la relation engagée.
À qui il arrive de mentir pour avoir la paix.
Qui joue les innocentes alors qu’elle est en train de manœuvrer pour arriver à ses fins.
Qui laisse espérer des choses alors qu’au fond elle sait qu’elle ne te donnera jamais ce que tu attends d’elle.
Qui parfois est obligée de faire machine arrière et devient alors impitoyable.
Qui te veut, toi, alors que ton cœur est pris, et qui est prête à faire ce qu’il faut pour t’avoir en se fichant des éventuelles conséquences.
Qui est un peu amoureuse d’un animal alors qu’elle a déjà donné son cœur à un humain.
Bref, c’est une connasse égoïste. Mais si c’en est une c’est parce que c’est comme ça qu’elle se sent bien, vit, respire, touche le bonheur du bout du doigt. Et quand elle se sent bien elle est généreuse. Elle essaie de gommer ses défauts, redouble d’efforts pour ne pas décevoir. Elle aime sans compter, vient au devant de toi, est attentionnée, à l’écoute, te donne tout ce que tu veux. Ses mots, ses bras, sa table, et même ses draps si besoin. Et si tu sais l’apprivoiser, elle se livrera à toi sans retenue. Sans fard elle se mettra à nu, et peut-être qu’elle te laissera entrevoir ce qu’elle cache au fond d’elle. Tout au fond. Ce qu’elle est vraiment.
Une connasse égoïste qui espère tellement ne pas te faire trop de mal.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 23 Mai 2014 à 18:07
La fusion. L’enchevêtrement des corps et des esprits. Comme si on s’était fait greffer un nouveau membre. Au début on trouve ça surprenant, c’est agréable mais on sait pas trop ce que c’est, on a jamais connu ça. Et puis on s’habitue. On en veut encore, plus, toujours plus. C’est grisant, la vie part à cent à l’heure, on se sent invincible et éternel. On sait que l’autre comprend tout, du moins on le croit. On se permet tout, c’est pas grave, il sait.
Et puis un jour le pas de trop, le mot de travers, l’acte impardonnable. Et tout s’arrête. Choc frontal, membre blessé, urgences, amputation. Commence alors le chemin de croix. Le syndrome du membre absent. La souffrance profonde, inattendue, et l’obligation de faire sans. Sans ce membre absent qui pourtant est là, on le voit, il s’agite, vit, s’affaire de son côté, semble respirer à peu près bien tout seul. Il n’est plus raccordé au reste du corps mais il respire encore. Ou a l’air, on n’en sait pas plus, la communication est brouillée, les codes ne sont plus très clairs, la connexion est coupée. Pourtant on cherche à savoir, à deviner, est-ce qu’il souffre autant, est-ce que la distance est aussi douloureuse pour lui ? Toutes ces questions qui restent sans réponse, puisque le choix qui a été fait est de ne pas titiller ce membre absent.
Ca démange, bien sûr, mais on sait bien que gratter les plaies ne ferait qu’arracher les croûtes. Tout ça n’est pas ragoûtant je vous l’accorde, mais la souffrance morale est souvent tellement similaire à une souffrance physique. Parfois elles se mêlent, même, la fameuse fusion, qu’on retrouve encore ici. Mais dans sa version sombre, celle de l’enfer, celle où l’on se consume malgré soi.
Alors maintenant il faut vivre avec. Ou plutôt sans, sans ce membre qui n’a pas été là pendant si longtemps mais qui, une fois raccordé, était devenu indispensable. On fait comme si, on tente de continuer à respirer, sans savoir vraiment quelle partie du corps on a perdu. Etait-ce un poumon, des tripes, une partie du cœur, un cerveau ? En tout cas un organe vital. Les pansements et compresses aidant, la blessure va cicatriser, pour sûr. Ce sera long, probablement, et bien sûr on espère une greffe rapidement, avant que la douleur ne soit trop usante. On guette le téléphone, en attente d’un appel du centre de greffe. Inlassablement. Parce qu’il nous est impossible de faire autrement. Parce qu’imaginer la vie sans ce membre est tout bonnement inconcevable.
Mais en relisant les statistiques du centre de greffe, il apparaitrait que les membres se réunissent toujours au final. Quel que soit le temps d’attente. Alors attendons. Et que ça vienne ou pas, surtout, faire un point sur soi-même et se remettre en question afin que ça n’arrive plus jamais avec aucun membre, d’origine ou rapporté.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 21 Mars 2014 à 14:17
Il ne se dit pas qu’il serait peut-être temps de me répondre, que le rendez-vous est dans trois jours et qu’il faudrait quand même que je prenne mes dispositions… Non. Silence radio. Je bous à l’intérieur, chaque minute qui passe me ferait imploser. Ma tension doit approcher le point de non retour.
Il doit être en train de chercher une excuse. Je le soupçonne d’être en train de me planter, et de ne pas savoir comment me le dire. Merde, c’est moi ou les gens manquent cruellement d’attention envers les autres ?
Moi j’ai appris à communiquer, à prévenir, anticiper. Eviter les malentendus. Certains disent que j’en fais trop, oui, je sais. Mais moi je préfère. C’est pas toujours heureux mais c’est souvent utile.
Il attend quoi, en fait ? Si c’est un problème d’organisation, qu’il me le dise, je peux m’arranger. S’il n’a plus envie, qu’il me le dise aussi, je vais pas le bouffer. Mais pas cette attente. Non, pas cette attente qui me ronge.
Il paraît que l’amour et la haine sont si proches qu’on pourrait les confondre parfois. Exactement, à cet instant je le hais. Croiser son regard m’insupporte et mon cœur bondit à la simple lecture de son nom. Pourtant je continue de l’écouter, encore, comme si je ne pouvais faire autrement.
Parce qu’il est en moi. Sacrément ancré en moi. Ses mots, sa voix, ses sons. Dans chaque pore de ma peau. Dans chaque poil qui se dresse quand je l’entends. Et cette entrevue, je la rêve depuis des années. Je l’attends depuis des semaines. Enfin le rencontrer. Croiser ses yeux, respirer son parfum. J’ai travaillé dur pour ça. Trouvé les moyens, les excuses, les raisons. Mis des choses en place.
Alors cette attente est insupportable. Mes tripes se retournent à chaque minute de la journée. J’en gerberais tellement ça fait mal. Mes mains tremblent et mon corps est désynchronisé de mon cerveau. Cet état dans lequel ça me met. Dans lequel IL me met. Impossible de relativiser. Impossible de garder la tête froide.
Le mode groupie je connais, je pratique depuis ma plus tendre enfance. Le mode amoureuse aussi, je suis une femme qui aime la vie et ceux qui sont dedans. Mais ce mode là je le connais pas. Le mode hypnotisée, possédée, dépossédée de tout bon sens et de toute jugeote. Incapacité totale de vivre pour autre chose que lui. Désarmée.
Ma vie n’a de sens que parce qu’il existe. Je ne sais pas quand c’est arrivé mais c’est arrivé. Et je n’ai pas lutté. Depuis je respire au rythme de ses mélodies, je n’écris que dans l’espoir qu’il me lise, je ne parle que dans l’espoir qu’il m’entende. Je me livrerais corps et âme pour lui. Un mot, un regard significatif et je m’abandonne. Il ne faudrait pas hein. Mais maintenant qu’il est là devant moi je sais que je lui appartiens. La question est de savoir si lui le sait.
***
J’ai hésité avant de venir. J’ai mis du temps à lui répondre, elle a dû croire que je revenais sur ma décision. Pourtant Dieu sait que j’ai envie d’être ici. Avec elle. Elle sur qui j’ai un œil depuis des mois, elle dont j’admire les mots. Si différents des miens et pourtant si identiques.
La voir, la découvrir, mettre un visage enfin sur tous ces écrits. Tous ces mots, toutes ces phrases qui parlent si bien de moi alors qu’on ne s’est jamais rencontré. Je ne m’explique pas comment elle me comprend si bien. Comment elle me devine si parfaitement. Comment même parfois elle anticipe mes sentiments et mes actes.
Le jour où j’ai cliqué sur le lien de ce blog j’ai souri, pour de mauvaises raisons. Je pensais tomber sur un énième fan-club cul-cul la praline. Et puis j’ai lu ses mots sur mon travail. Tellement justes, tellement précis. Elle a décelé chaque intention, chaque émotion, chaque double sens. Comme si nos cerveaux étaient connectés.
Et dans tous ces mots sur moi il y a tellement d’elle. Elle se livre tellement à travers moi. J’ai l’impression de la connaitre par cœur, et j’espère ne pas me tromper. Parce que je ne me remets pas de ce que j’ai découvert. De celle que j’ai découverte.
J’ai donc plongé dans son univers. Cet univers qui raconte le mien, cet univers dont je suis devenu accro. Avide de ses mots, j’ai fini par être avide d’elle. Elle qui est maintenant là devant moi. Et pour la première fois de ma vie j’ai peur. Du haut de mon mètre quatre-vingt dix, pour la première fois de ma vie j’ai peur de ne pas être à la hauteur.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 11 Mars 2014 à 13:10
La Vie, ce grand sac de nœuds. Parfois même de têtes de nœuds, hein. Mais ça c’est une autre histoire. Aujourd’hui c’est la vie qui m’a sauté à la figure, celle qui est si tordue, si belle, si courte, si compliquée. Celle qu’on traite de putain parfois, mais qu’on a tellement peur de quitter. Celle qui t’offre des cadeaux, précieux ou empoisonnés, parfois les deux. La vie qui surprend, emporte, détruit, fait renaître, disparaître, aimer, haïr. La vie qui fait briller tes yeux, couler tes larmes et te vider de ton sang. Montrer toutes tes dents. Les crocs quand t’as les nerfs, mais surtout les autres quand ta bouche s’ouvre d’une oreille à l’autre. En forme de sourire, tu sais. Ça arrive quand t’es heureux.
Et cette vie ben tu la vis pas tout seul, hein. C’est ça qui fait sa richesse. Enfin je crois. Oui, j’en suis sûre même parce que si t’étais tout seul il n’y aurait pas toutes ces émotions, tous ces coups au cœur, toutes ces crises de nerfs ou de larmes, ces cris de joie et de bonheur. Ça c’est à cause de l’autre. Celui qu’est en face de toi. Qui te regarde, ou pas, qui te sourit ou t’insulte, qui te prend dans ses bras pour le meilleur et pour le pire. Le pire de lui, parfois, bien sûr, sinon c’est pas drôle. Le pire de toi aussi qu’il accepte ou rejette. Mais surtout la magie. La magie de la connexion. De la compréhension et de l’investissement.
Des fois ça prend du temps, des années, la famille c’est bien compliqué malgré les liens du sang. Mais finalement il n’y a que deux options : ça marche ou ça marche pas. Que tu te battes pour y arriver ou que tu laisses pisser.
Des fois en amour aussi ça prend du temps, pas des années parce que la baise facilite grandement les choses, tu sais, la fameuse réconciliation sur l’oreiller. Bon ça embrouille aussi pas mal, d’accord, parce que le cerveau du bas il est pas toujours raccord avec celui du haut. Faut pas hésiter à faire les MAJ quoi. En passant par le cœur de préférence.
Des fois ça prend du temps, des années, on ne fabrique pas une amitié en quelques secondes hein. Il faut apprendre à se connaître, se comprendre, s’apprécier. Se supporter.
Et puis des fois c’est fulgurant. Tellement fulgurant que tu sais plus trop où t’en es, tu sais plus trop ce que c’est, amour, amitié, fraternité ?
Entre sexes identiques c’est facile (ou à peu près). Le fonctionnement est sensiblement le même par défaut, alors si en plus la connexion est là c’est vite le septième ciel. Parfois tu vas jusqu’à aimer cette personne bien plus fort que certains membres de ta famille. C’est mal, tu le sais, mais t’y peux rien hein. La force des sentiments.
Mais entre sexes opposés la relation est vite biaisée (j’ai bien mis un « i » avant le « a » non mais). Surtout s’il y a des kilomètres au milieu. Ceux qui empêchent les yeux de se croiser, les mains de se toucher et les sourires de s’exprimer. Du coup il y a les retenues, les peurs, les attentes. Les mêmes des deux côtés ou au contraire celles qui s’opposent. Toi tu veux tout donner, tout prendre, vite, comme tu sens que ça colle bien tu veux pas laisser sécher. L’autre pense sûrement pareil, mais il sait pas trop comment le dire. Alors vous tournez autour du pot. Et un jour le pot vacille, se casse, déséquilibré par votre ronde incessante. Tu contemple les débris, impuissant, t’en ramasse un au passage mais tu sais pas trop quoi en faire. C’est donc le moment de ressortir la colle. Y’en a plein des différentes, faut pas se tromper. Faut bien la choisir. Faut pas prendre celle qui reste sur les doigts, celle qui pue, celle qui colle trop fort avant que t’aies pu bien ajuster les morceaux. Il faut celle qui fera ça en douceur et qui ne laissera pas de traces. Ou alors invisibles. Parfois cette colle c’est un geste, une attention, un sourire. Et parfois elle se résume en un mot. Un seul. Un mot qui soudain éclaire tout, clarifie la relation et consolide les sentiments. Celui là tu le choisis pas, il sort tout seul. Comme un diable hors de sa boite. Toi-même il te surprend, ou peut-être pas, tu l’as sûrement pensé tellement de fois. En tout cas il a été dit, écrit, répété, compris, et le pot a été recollé. Il reste fragile, ce pot, bien sûr, mais maintenant t’as compris que la meilleure colle finalement c’est les mots. Il faut les dire. Il faut surtout savoir les entendre, sans en avoir peur. Et demander si tu les comprends pas. En détente, quoi, tavu. Tranquille.
Et ces mots qu’il faut savoir dire et entendre, apprécier et accepter, finalement ça marche pour tout. La communication, baybee. C’est la clé de cette vie.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 22 Janvier 2014 à 18:21
1.Donner : verbe intransitif
Produire, procurer du rendement. Ex : « Les fraises donnent cette année ». Synonyme : rapporter
2.Donner : verbe transitif
Remettre, transmettre, offrir, fournir sans rien en retour. Synonyme : communiquer.*
« Sans rien en retour ». Cette intention est très louable, sur le papier. Très altruiste. Mais n’est pas viable, hein, on est bien d’accord. Donner implique forcément un échange. Alors bon, d’abord on ne s’en rend pas compte, on est ravi, c’est le plaisir du réconfort que reçoit l’autre qui compense et fait gonfler le cœur. Tu te dis que ça te suffit, que toi t’as besoin de rien, que t’es fort et que c’est beau tout ce que tu peux apporter à l’autre. L’autre qui le mérite, bien sûr. L’autre qui a toutes les qualités du monde au milieu de ses défauts, l’autre qui déborde d’émotions et de tendresse, d’humour et d’amour. L’immanquable. Celui ou celle qui est entré dans ton cœur et qui n’en sortira jamais. Des fois y’en a plusieurs même, quel cadeau te fait la vie.
Et puis les jours passent. Les événements, les émotions, et un jour tes bras tombent. Tes bras tombent parce qu’ils sont trop lourds, parce que tu as trop porté les paquets des autres, parce que même si on t’a proposé de te soulager t’y es pas allé à fond bien sûr. Parce que c’était pas à toi de pleurer, de te faire plaindre, toi ça va aller. Qu’ils ne s’inquiètent pas surtout. Alors les paquets des autres restent sur tes bras, même les jours où ces autres préfèrent te laisser de côté. Quand ils s’enferment. Dans leur tête, dans leurs verres, dans leur grotte, dans leur vie. Leurs vies parfois si compliquées. Dans ces moments là tu te dis qu’ils ont besoin de ça bien sûr, que toi ce n’est pas pareil bien sûr, que toi tu vas bien. Mais tu t’inquiète. Pour eux, toujours. Jamais pour toi. Tu t’inquiète et ça te bouffe. Ca te grignote petit à petit, de l’intérieur, chaque jour un peu plus. Plus tu t’inquiète et plus tu donne aussi, bien sûr. Et tu te vide. Sans t’en rendre compte.
Et puis un soir, il y a un geste. Ou un mot. Une attitude. Et là tu réalise que toi t’es pas bien. Que toi aussi t’as besoin des autres, finalement, que tu t’es retenu mais que t’aurais dû craquer. Te soulager. Tout envoyer balader et pleurer un bon coup. Mais non, hein, tu ne l’as pas fait. Parce que tu n’en avais pas besoin. Tout ira bien tu disais. Ca va passer. Ca va aller. Mais en fait non, ça ne va pas, et maintenant c’est trop tard. Au moment où tu craque ben personne n’est là. Ou ceux qui sont là ben tu ne peux pas leur dire. Alors tu étouffe tout ça. Tu retiens les larmes, les nerfs, la fatigue. Cinq minutes. Mais il faut que ça sorte. Et là, heureusement, y’a quand même quelqu’un. Quelqu’un qui t’entend, qui t’écoute, qui te répond. Qui te soutient. Qui t’engueule aussi, qu’est-ce que tu fous à te prendre la tête au lieu de dormir. Quelqu’un qui donne tellement, trop à son goût mais qui du coup sait recevoir.
Parce que finalement, est-ce que toi tu sais recevoir ? Oui, sans doute… Mais pas à moitié alors. Pas par intermittence. Pas un jour sur deux. Pas quand toi tu vas tellement bien que t’ose pas le dire pour pas faire plus de mal encore à l’autre qui va pas fort. Pas quand l’autre va trop bien lui aussi pour voir ou trop mal pour être là. T’as pas appris l’intermittence toi. T’es toujours là pour les autres. T’es jamais #Off. Jamais. Va falloir apprendre alors. Va falloir apprendre à craquer, va falloir apprendre à te distancer toi aussi. Parce que la vie est une salope bien vicieuse, qu’elle te bouffe sans que tu ne t’en rendes compte. Faut la tenir à distance. Pour la mater. La gérer, l’assumer. L’apprécier aussi et la choyer surtout. Pour pouvoir continuer à donner, tout, et même le reste, à ces autres pour qui t’as l’impression que tu pourrais crever.
Ces autres, ceux que t’as failli perdre, ceux que tu as perdu, ceux que tu perdras jamais, et qui sont tous dans ton cœur. Qui vont y rester longtemps. Va falloir assurer, hein. Va falloir être plus transparent quoi. Va falloir accepter qu’ils prennent un peu de ton désarroi parfois, parce que sinon un jour tu vas imploser. Comme un ballon de baudruche. Et puis va falloir accepter que ça soit trop pour eux, et que vos liens en pâtissent. Pour pas que toi tu en crève.
Trop pour elle, qui a sa vie et ses envies, ses problèmes et ses questions aussi, mais toujours un mot gentil au détour d’un réseau.
Trop pour lui, qui préfère se consacrer à son mal être, sans pour autant le gérer comme il faudrait sans doute.
Trop pour lui, qui a préféré aller voir ailleurs si tu n’y es pas. Au moins c’est réglé.
Trop pour elle, qui serait sans doute plus présente si la pudeur qui vous sert de carapace se fendillait un peu.
Trop pour lui, qui ne sait pas tout et qui saura sans doute jamais.
Trop pour lui, qui ne demande rien mais t’apporte les sourires dont tu as besoin et les rires qui font passer le temps un peu mieux. Les jolis mots et une image de toi tellement proche de ce que tu essaie d’être en vrai.
Trop pour elle aussi, qui ne sait plus trop où elle en est, et que tu lâcheras jamais parce qu’une rencontre comme ça ça n’a pas de prix. Parce qu’elle est en toi, parce que tu espères qu’elle n’en sortira jamais.
Donner, ça s’apprend. Apprends bien ta leçon alors. Y’a interro tous les jours dans cette putain de vie.
*(source : www.linternaute.com/dictionnaire/fr)
L’exemple sur les fraises est vraiment tiré de cette source. Un signe ?
 10 commentaires
10 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 15 Janvier 2014 à 08:52
Elle. Fringante demoiselle. Explosive personne. La boule de vie qui te prend un jour et ne te lâche plus, en tout cas tu l’espère car la chute serait plutôt mortelle. Sa main qui te serre les tripes. Les tordent en deux tellement elle est crispée de vie et d’énergie. Ses yeux qui s’agrippent à ton sourire, le surveillent de près, de loin, de tout tout le temps. Tu en as mal aux zygomatiques tant tu ne le l’abandonne plus. De peur qu’elle l’oublie. De peur qu’elle t’oublie.
Et puis il y a ses larmes. Ses larmes qui t’inondent, toi, parce que c’est devenu ta siamoise. Tu brûle avec elle. Tu sauterais avec elle s’il le fallait. Ses larmes tu les prends, toutes, pour ne plus qu’elle en ait. Même si au fond de toi tu sais qu’elles sont intarissables. Elle est entière, entièrement, elle vomit de l’amour à force d’en produire. A force de laisser battre son cœur à tout rompre, comme si la vie allait s’arrêter maintenant. Cette vie si pleine, si lourde, qu’elle porte à bout de bras et qui l’épuise régulièrement. Ce besoin de bouffer les papillons, tout crus, pour les sentir palpiter au creux de son ventre de femme-enfant. Endormir la petite fille qui veille au fond d’elle. Qui a peur du noir, des méchants, et qui a peur de rester seule. Tellement peur.
Plantée sur ses deux jambes, les pieds ancrés dans ses 12 cm toutes neuves, elle espère éviter les embûches. Sa vie est bien mieux que ça. Sa vie c’est une danse perpétuelle, parce que la vie est un cadeau à dévorer sans retenue. Sans regret, sans souci, sans barrière. LA VIE. Et son lot de casseroles. Celles qui l’aident à avancer, celles qui lui font honte, celles qui l’empêchent d’être ce qu’elle est, celles dont elle est plutôt fière. Une batterie de cuisine à mi-chemin entre le resto gastro et la cafèt de bas étage. Mais c’est elle, ça.
Elle le digère en avançant, tremblante, sur ses talons de fashion victim à peine assumée. Trop bourrine pour ça. Tremble, sister. Pleure, ries, hurle, bats toi. Claque les, emmerde les, aime les, baise les. Vis. Mais ne t’oublie pas. Jamais. Parce que moi je serai là pour te rappeler à ton bon souvenir.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 7 Janvier 2014 à 18:48Ce texte est une composition de plusieurs membres de la #TeamEcriture, dont le principe est de jouer avec les mots. Cette fois la plus jeune d'entre nous a commencé une histoire que chaque participant suivant devait continuer. La seule contrainte étant le nombre maximum de mots, soit 300. Voici ma partie, retrouvez l'intégralité du texte ici... Bonne lecture ! Et retrouvez le texte en audio ici !
[...]Son corps tremble un instant au moment où ils basculent. Elle serre sa main plus fort encore, surtout ne pas la lâcher, et aperçoit du coin de l'oeil son sourire. Il ne la lâche pas non plus. Ne lâche pas son âme d'une semelle tout au long de cette lente et excitante descente vers ce qu'elle croit être, à ce moment là, le reste de sa vie.
Leurs pieds se posent simultanément sur un sol moelleux, brumeux, elle ne distingue pas bien ce qui s'y trouve. Elle se retourne vers lui, l'air interrogateur.
"Bienvenue chez toi", lui dit-il avec un sourire. Un sourire différent. Un sourire étrange. Elle ne le remarque pas immédiatement mais comprendra plus tard ce que ce sourire voulait dire. Elle observe les alentours et ne peut s'empêcher de trouver l'environnement sombre, et fronce les sourcils devant ce spectacle. Cette brume, recouvrant tout le paysage. Elle devine seulement des ombres, bien trop imprécises pour pouvoir déchiffrer quoi que ce soit.
D'une impulsion de la main il lui intime l'ordre d'avancer, et les voilà partis sur ce chemin semblant mener vers l'infini. Tous ses sens sont en éveil... Et elle commence à distinguer des sons. Des voix féminines, de fillettes pour être exacte. D'une fillette. Et soudain elle se fige. Elle reconnait des mots. Des noms. Lui tire sur son bras, il veut continuer le chemin. Mais elle reste ses deux pieds plantés dans ce sol étrange. Un larme coulant sur sa joue.
Il se tourne alors vers elle et ce sourire étrange s'affiche à nouveau sur son visage : "Je t'avais prévenue" lui dit-il d'un ton grinçant. "Bienvenue chez toi".[...]
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 5 Janvier 2014 à 15:05
Je plante le décor. Dimanche matin, soleil radieux. Vue sur mer bleu dur et ciel immaculé. Mon balcon. Froid glacial, le Mistral engourdit les membres et chair-de-poulise chaque molécule de peau. Nevermind. Le sacro-saint café-clope du matin mérite bien ce genre de compromis. Mon esprit s’évade le temps que le nectar ébène coule dans ma tasse Smiley « yeux en forme de cœurs » rose, et va se poser sur le souvenir de ma conversation d’hier soir. Il défriche un peu le terrain, embrumé par le sommeil, et y retrouve une information capitale : j’ai de la lecture. Sourire. Grand sourire. Les coins de ma bouche cherchent une issue dans le secteur de mes oreilles. Je prends alors mon PC sous le bras, m’installe sur mon fauteuil et savoure l’instant. Légèrement tremblante, sûrement à cause du Mistral Glaçant, j’ouvre le fichier et me plonge avec délectation dans cette histoire rock ‘n rollesque à souhait, précise comme la pointe d’un talon aiguille aiguisé par une fashionista avide de chair, souriante comme le Joker sous ecstasy un soir d’abandon total aux plaisirs de la vie la vraie. #ApeuPres
Je parcours les pages le souffle court, fébrile, emmenée par le tourbillon du verbe et la mise en page atypique. Un régal. Chaque mot est un véritable bonbon, enveloppé dans des phrases colorés et scintillantes comme les emballages de papillottes (c’est Noël ou bien ?!). L’art et la manière. Sensations. Ravissement. Vingt-trois pages, vingt-trois raisons de sourire d’une oreille à l’autre. Rester ainsi jusqu’à la suite… Un sacré bitchy vertigo.
Retrouvez Bitchy Vertigo Vanitas par Antoine Del Cossa sur Amazon et Blurb
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 10 Décembre 2013 à 18:23
Je m’imagine descendre du train, poser mes talons sur le quai de la gare et te chercher parmi les visages s’affairant dans le hall.
Je m’imagine dans cette chambre d’hôtel, te guettant par la fenêtre, sursautant au bruit de la porte qui s’ouvre dans mon dos.
Je m’imagine à la terrasse d’un café, grelottante de t’avoir trop attendu dans le froid, et réchauffée soudain par tes bras autour de mes épaules.
Je m’imagine assise sur un banc, au milieu de ce parc que j’aime tant, et sentir tout à coup tes baisers sur ma nuque.
Je m’imagine en larmes, déroutée par ce tragique évènement, tes mains chaudes essuyant les larmes sur mes joues.
Je m’imagine épuisée, fourbue d’avoir trop vécu cette intense journée, m’endormant dans tes bras et le nez dans le creux de ton cou.
Je m’imagine une cigarette à la bouche, ta main approchant un briquet pour l’allumer, tes yeux plantés dans les miens.
Je m’imagine avec toi, au milieu de la foule, les pommettes rougissantes à l’idée que ta main pourrait s’introduire sous ma jupe.
Je m’imagine sur le point de rentrer chez moi, adossée à la porte, toi contre moi pour un dernier baiser et là, ta main sous ma jupe.
Je m’imagine dans ce grand lit, essoufflée, toi en moi et mes jambes autour de tes hanches.
Je m’imagine après, m’endormant paisiblement tandis que ta main caresse mes cheveux.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 9 Décembre 2013 à 20:55
Ces mots que tu ne peux pas écrire. Que tu préférerais dire, mais que tu ne peux pas non plus. Ces battements de cœur, ces coups de poings dans ton estomac. Ces longues minutes de paralysie. Ces frissons qui parcourent ta colonne vertébrale, te glaçant le sang au passage. L’attente interminable entre deux échanges. Les sursauts à chaque message reçu. Cette impression que tu vas imploser à chaque signe de l’expéditeur, celui là même qui te met dans cet état. Ton regard dans le vide, cherchant des raisons de ne pas imploser. Ta tête que tu voudrais cogner contre un mur pour oublier. Ton esprit qui cherche à fuir ce qui te paraît bien trop compliqué. Ta belle assurance que tu perds dès qu’il faut lui parler. Les bégaiements, les hésitations et le ridicule quand tu y repense, pleine de regrets.
Et puis ton sourire. Ce sourire béat dès que tu lis ses mots, que tu entends sa voix. Tes jambes qui flageolent quand il pose ses yeux sur toi. Le léger balancement de ton corps quand il te parle. Ce bonheur qui t’envahit, qui fait trembler tes mains à l’idée d’être auprès de lui. Ta peau qui frémit à chaque fois qu’il te frôle. Ta poitrine qui se gonfle à chaque inspiration, essayant d’emprisonner en toi chaque molécule de son odeur. Ce vertige qui s’empare de toi quand tu crois l’apercevoir dans la foule. Tes yeux, brillants, que tu lève au ciel devant tes gamineries. La honte de devoir te cacher, parce que tu n’es pas seule et que l’autre pourrait être blessé. Les mensonges que tu échafaude, au cas où l’occasion se présenterait. Juste au cas où.
Au cas où tu aurais le courage de fuir cette vie que tu aimes par-dessus tout, pour t’échapper vers un frisson interdit dont tu ne sais rien. Dont tu as peur. Peur d’aimer, de détester, de regretter. Peur des conséquences. De la déception. Peur de perdre ce rêve, peur de perdre l’autre que tu chéris tant. Peur de ne jamais plus retrouver ce grondement dans tes tripes, cette adrénaline envoûtante qui te fait vibrer chaque jour un peu plus. Tout mais ne pas perdre ça. Alors ça tu le gardes au fond de toi, tu savoures en silence les joies et les peines qu’il te laisse. Retiens autant de larmes que de sourires. Serre les poings souvent, le ventre parfois. Le ventre surtout, pour ne pas laisser échapper les papillons qui s’y trouvent.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 28 Novembre 2013 à 21:26
“There’s something inside you
It’s hard to explain”
Kavinsky
- Jewel Box -
La quarantaine approchant à grands pas, il va quand même falloir que je me rende à l’évidence et que j’accepte mon sort : je suis une artiste. Je peins, je décore, je chante, je fabrique, j’écris, bref, je crée. Comme tout artiste qui se respecte je suis lunaire, sensible, entière, à fleur de peau, absente, bordélique, généreuse, préoccupée, parfois irascible, mais gentille le plus souvent possible. Et comme tout artiste qui se respecte j’ai plusieurs vies, et j’enchaîne les coups de foudre, qu’ils soient sonores, visuels ou amicaux.
Cette vie de créatrice est inondée de musique, nourriture incontournable inspirant sans cesse mon cerveau torturé. Alors les artistes qui la fabriquent font forcément partie intégrante de cette vie, se changeant même parfois en muses, que je le veuille ou non.
Il y a d’abord eu l’enfance, marquée par des étés dansants, dans une discothèque de camping improvisée par les propriétaires dans leur propre grange, où se croisaient quelques beaux gosses tout droit sortis du Mia d’IAM et des familles admirant leurs progénitures se trémousser sur les tubes disco. J’y ai découvert Madness, Giorgio Moroder, Scorpions, les premiers slows, et les effets de l’alcool sur des adultes éméchés essayant d’attraper les éclats de lumière projetés sur les murs par la boule à facettes.
Ensuite est venue l’adolescence, le métal, le rejet de ce que l'on estime être ridicule, non, j’écoute pas de chanson française vous rigolez ou quoi. Se casser la voix sur les refrains de Sepultura, se faire des mèches rouges et porter des jeans déchirés comme Kurt Cobain. Avoir besoin de sentir que les autres souffrent avec vous, que cette rage est partagée. Korn est alors arrivé à point nommé. La souffrance et la rage, donc, expulsées dans des râles à vous tordre les tripes. Mes textes de l’époque se sont vus soudainement ponctués de fuck à chaque coin de phrase. La pop anglaise est bien venue adoucir un peu tout ça ensuite, mais la toile musicale de ma vie est restée définitivement rock. And roll.
L’envie de partager m’a naturellement conduite dans les locaux de radios locales, animatrice sur Utopie d’abord et Grenouille ensuite, puis dans l’organisation de concerts pour quelques années d’immersion dans ce milieu qui m’est si cher. De cette époque me restent de formidables souvenirs d’interviews improbables (Serj Tankian sortant de sa douche dans les loges du Dôme, Ben Harper qui me file des backstages pour qu’on parle de Jeff Buckley ensemble après son concert, ou la toute première, Troy Von Balthazar à la volée sur un muret en face de l’Espace Julien). Les démos formidables de Dust ou Tuscaloosa, groupes à la carrière malheureusement éphémère, et la fierté d’avoir co-organisé les seuls concerts hommage à Jeff Buckley en France.
Car un jour Jeff a pointé le bout de son nez, et je pense qu’après ça plus rien n’a été comme avant. Le choc a été si violent que presque vingt ans plus tard je ne m’en remets pas. Un éclat de diamant dans un flight-case, c’est ainsi que je le vois. Et depuis j’ouvre les flight-cases à tour de bras, à la recherche de nouveaux diamants, de cette émotion si particulière que procure le mélange du rock ‘n roll et de la sensibilité à fleur de peau d’un homme torturé à la voix d'ange.
C’est en ouvrant celui de Julien Doré que j’ai découvert Arman Méliès, et que je m’inflige désormais ses tortures volontaires. Il love mes préoccupations de mère de famille dans des draps de soie, il accentue parfois la mélancolie que laissent derrière eux les moments de doute et de faiblesse d’une éternelle fillette qui tente de se débattre dans un monde d’adulte. Alors quand il vient rajouter à tout ça des sons semblables à ceux qui ont bercé mon enfance, puisant dans les années quatre-vingt la juste dose d’influence suffisant à faire vibrer l’éternelle nostalgique que je suis, je suis obligée de lui donner une bonne place au Panthéon de mes idoles, sans doute ex-æquo avec un Eddie Vedder ou un Thom Yorke, et jamais très loin de Jeff.
*
- Dead Boys are back in town -
Et puis suivant Arman de très près, il y a eu Joseph. Il se dit d’Anvers mais vient de Nevers, a écrit pour Bashung et Dick Rivers, aime les road-movies américains, la couleur rouge, préfère la boxe au foot (surtout depuis qu'il a laissé un tendon d'Achille au fond d'une paire de crampons) et les likers. J’ai écouté, aimé, et son troisième album m’a marquée au fer rouge. Comme Arman, il a puisé juste ce qu’il fallait dans les sons électroniques pour révéler toute l’originalité de ses morceaux. Il a été mon compagnon d’infortune lors de mes escapades professionnelles à Paris, a habité mes oreilles dans le métropolitain, et mes yeux (car il écrit, aussi) pendant mes longues soirées d’isolement dans l’antre prêtée par un ami aux abords du quartier de Belleville. Depuis j’essaie même de poser ma voix sur ses mots, timidement, respectueusement, je tente d’incarner la femme qu’il décrit si bien dans Ma peau va te plaire, magnifique chanson initialement destinée à Bashung (Ha !).
Joseph D’Anvers, c’est un front immense et des yeux lumineux, plantés dans la cour du resto de la Maroquinerie après un concert d’Arman Méliès. Un charisme à tout casser, effrayant, m’empêchant d’aller lui dire à quel point je l’admire.
Joseph D'Anvers écrit, aussi, disais-je plus haut. Une histoire sombre de pluie interminable, d'amour torturé et de meurtres sur fond de rock 'n roll.
Joseph D'Anvers raconte, également. Les Dead Boys, héros de nouvelles écrites par Richard Lange. Il a décidé d’en faire un spectacle, atypique, en forme de road-movie musical, dans lequel il donne vie à ces personnages désœuvrés et bruts de décoffrage.
Joseph, c’est aussi un homme de son époque, connecté aux réseaux sociaux, qu’il maîtrise à merveille. Il sait l’impact d’un like, d’un commentaire bien placé, d'un post intimant avec humour l’ordre de partager divers évènements… Il a compris l’importance d’une réponse à un mail timide, dans lequel je tente de dire à distance ce que je n’ai pas osé lui dire de plus près. Alors de mails en commentaires, de like en smiley, la glace s’est brisée, et l’impressionnant artiste a peu à peu fait place au musicien accessible et sympathique, ne faisant qu’augmenter mon envie de le rencontrer et d’échanger quelques mots avec l’homme.
La première des Dead Boys à Paris a failli m’en donner l’occasion, mais un empêchement de dernière minute m’a obligée à attendre encore. La vie reprend donc son cours. Le boulot, l’inspiration, trop d’idées et pas assez de temps… Et la Friche, que j’aperçois de ma fenêtre, lieu atypique par excellence, ancienne manufacture de tabac reconvertie en pôle culturel et artistique, que j’imagine hantée par quelques Dead Boys oubliés. Un jour, peut-être…
En attendant, c’est à Manosque qu’ils ont décidé de poser leurs valises. Ils se rapprochent. Mais si, c’est Facebook qui me l’a dit, ils arrivent le vingt-sept septembre à vingt-deux heures trente. Enfin ! Enfin… S’il reste des places, merde, je l’ai échappé belle, j’ai chopé les deux dernières, il a du succès le bougre ! Après une heure et demie de route (oui, on a raté la sortie, deux nanas qui papotent en bagnole, vous êtes surpris ?!) on approche du but, le Café Provisoire montre timidement le bout de son nez dans la nuit encore bien tiède d’un été qui s’éternise. Il y a un spectacle avant, Jacques Gamblin je crois, on attend que les gens sortent, le cœur battant, l’excitation grondant au fond du bide…
Les portes s’ouvrent enfin et c’est d’un pas robotique que je pénètre dans la salle, aperçois les coussins dispersés sur le sol pour ceux qui se mettront devant, mais je choisis le confort des chaises, un peu plus en retrait. Encore un peu d’attente et la lumière s’éteint, le voilà, boitillant (son tendon d’Achille est encore faible), s’installant dans un silence religieux, et le spectacle commence. Hypnotisée je suis. Les Dead Boys sont là, paumés, rageurs, pénétrants. Ils sont tous différents et pourtant parlent d’une seule et unique voix, celle de Joseph, qui les raconte avec une vérité fascinante. Il leur prête sa musique, leur invente des envolées de guitare, habille ainsi des mots qui lui collent à la peau, comme si c’étaient les siens. Quand il lâche sa guitare, c’est pour donner plus de rythme encore à ces mots, avec ses mains et parfois même ses épaules, comme un boxeur. Comme un ancien boxeur, tiens, c’est vrai qu’il l’a été. S’en est-il rendu compte ? Les mots deviennent ainsi les armes tranchantes d’un combat sans merci entre le conteur et les contés. Je réalise alors à quel point je suis ravie d’être ici, me dis que je me contenterai quand même difficilement de la version alternative, quand, après un silence vide d’applaudissements (le public a attendu la toute fin pour ça. D’abord surprise, j’ai ensuite trouvé que la représentation prenait ainsi une toute autre dimension…) il entame une mélodie que je connais. Je souris en pensant qu’il fait bien de recycler ses propres musiques quand de nouveaux mots arrivent : les siens. Car ce que j’ignorais, c’est que le road-movie, déjà bien captivant, était ponctué de quelques morceaux à lui (dont Ma Peau Va Te Plaire, putain mon cœur s’est arrêté de battre).
Après les fameux applaudissements tardifs marquant la fin, encore sonnée par ce déferlement d’émotions, je rejoins le bar du Café Provisoire afin de reprendre mes esprits. Et après un café-débriefing avec ma co-voyageuse, j’aperçois Joseph pointant le bout de son nez, une béquille à la main. J’hésite un instant, un court instant, non cette fois je ne laisserai pas passer l’occasion. Je l’interpelle timidement, heureusement Facebook a déjà fait les présentations, le contact est plus facile et la conversation démarre toute seule autour du spectacle. J’en profite pour lui faire signer son livre, les deux éditions, j’ai toujours eu un côté groupie, j’avoue et j’assume… Il me dit combien il faudrait voir la version intégrale du spectacle, oui, je sais bien, tu penses, mais la prochaine à Paris est en pleine semaine et je bosse, of course, alors à quand les Dead Boys à Marseille ?
On se dit au revoir, il est attendu et moi aussi, je lui souhaite le meilleur pour la suite, il est tard et j’ai du chemin pour rentrer. On se dit à bientôt, de toute façon Dead Boys n’en est qu’à ses débuts, on se recroisera sûrement quelque part… Il n’oublie pas de me recommander la plus grande prudence sur la route, attentionné en plus, voilà. Joseph.
Joseph, j’avais envie de le prendre par le bras pour l’emmener chez moi finir la discussion autour d’un café, parler de tous ces mots, de tous ces sons, qui se muent en émotions si intenses. Parler de son histoire, de son bagage artistique, de ses influences, tiens, j’ai pas été journaliste moi à une époque ? Déformation professionnelle sans doute…
Joseph, j’avais envie (mais peur !) de lui jouer ma version de sa chanson, de lui présenter mon amoureux avec qui il s’entendrait sûrement à merveille, dans un monde parfait ils se taperaient le bœuf dans mon salon.
Joseph D’Anvers, qui après trois albums et un roman vient de rajouter une corde à son arc et de s’installer définitivement dans le trio de tête de mes favoris, poussant du coude au passage Pearl Jam et Radiohead, déjà bien bousculés par Arman Méliès…
Et comme j’ai de la chance (je suis née un vendredi treize, sans rire), il s’avère que par une étrange coïncidence je serai en vacances le 31 octobre, j’avais oublié, dis. Je ne louperai donc pas les Dead Boys à Paris. Ouf.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 13 Novembre 2013 à 20:45
Des semaines qu’on a pas vu un bout de ciel bleu, un morceau de rayon de soleil, un semblant d’éclaircie. Nina ne s’en est pas vraiment rendu compte, à vrai dire elle est très peu sortie ces derniers temps. Son esprit est ailleurs. Elle vient de finir ses toiles, des jours qu’elle peint sans s’arrêter, des jours qu’elle ne pense qu’à Simon. Son visage est partout. Ses pinceaux l’ont kidnappé. Elle qui était si réticente à l'idée de retomber amoureuse, la revoilà le cœur battant et les papillons dans le ventre. Alors la pluie, elle n’en pense rien. Elle s’en fout.
Quand il arrive au rendez vous elle l’attend à côté du parc, abritée sous un porche. Elle est drôle. Elle est belle. Elle rayonne. Il se dit qu’il pourrait ne plus se passer d’elle, si seulement elle voulait bien de lui. La pluie repart de plus belle et le vent se lève aussi, sale temps pour un rendez-vous amoureux. Il lui attrape la main et ils partent en courant, dévalant la rue jusqu’au métro, et déboulent trempés sur le quai en pouffant comme des gamins. Elle a froid, elle commence à grelotter. Simon la prend dans ses bras pour tenter de la réchauffer. Parfois, le mauvais temps rapproche les corps.
Une fois chez lui ils se sèchent tant bien que mal, les cheveux trempés de Nina gouttent sur le sol et la barbe de Simon scintille comme la surface agitée d’un lac en plein soleil. Elle s’approche et lui caresse la joue de sa main, faisant disparaître sous ses doigts les diamants laissés par les gouttes d’eau. Elle plonge dans ses yeux gris, ils ont la couleur du temps, elle repense un instant à la pluie dehors et se sent bien, au chaud, ici, avec lui. Elle se blottit contre lui et enfouit ses mains glacées sous son pull.
« Simon, j’ai tellement besoin de toi »
La phrase que Nina lui chuchote à l’oreille le fait chavirer, il sourit malgré lui et la serre plus fort encore. Ils basculent sur le lit et leurs corps se trouvent enfin, ignorant l’orage tonitruant qui fait trembler les vitres.
Pendant la nuit, profitant d’une accalmie, Simon sort sur la terrasse pour fumer une cigarette. Assis sur le muret, il observe Nina dormir à travers la fenêtre mouchetée quand il reçoit une première goutte. Il se lève et tend son visage vers le ciel. L’averse s’intensifie et il reste là, planté, les bras en croix, un sourire béat sur son visage, absorbant toute l’énergie du déluge qui s’abat sur la Terre. Il ne s’est jamais senti aussi vivant.
*Cette histoire est une modeste première participation à un jeu d'écriture initié sur la page Facebook du blog de Miss Thé Rieuse. Le thème était la pluie, l'histoire devait être gaie. Vous retrouvez les autres participants sur leurs blogs
Allez-y, c'est permis et même chaudement recommandé ! Un simple clic sur leur prénom et vous y êtes : chez Fifi, Emilie, Jay, Blandine, Greg, Venise, Isabelle ... Merci à tous !*
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Cinnamon Fraise le 8 Novembre 2013 à 13:12
Nicolas est un petit garçon. Un petit garçon surdoué, impressionné et impressionnable. Un petit garçon qui admire son père, ce génie, ce héros.
Nicolas est un adolescent. Un adolescent curieux, cultivé, rebelle. Qui tente de combattre l’héritage familial, essayant de se construire en absorbant tout ce qui passe à sa portée, ne se sentant vivant que dans l’excès.
Nicolas est un homme. Un homme fragile, fragilisé, fragilisant, qui porte le fameux talent de son père sur ses épaules, ce lourd fardeau si déséquilibrant.
Un homme qui porte un nom, qu’il aurait été inutile de changer tant ses gènes en sont imprégnées. Imprégnées au point qu’il en crèverait. Overdose de génie créatif.
Nicolas se meurt, étouffé par ses démons et étranglé par les vipères médiatiques. Il tremble de n’être à la hauteur, frémit à l’idée qu’on pense qu’il ne l’est pas. Si sûr de lui quand il écrit, si troublé quand il est décrié. Le petit garçon, l’adolescent et l’homme se livrent en lui un combat sans merci, avec comme armes ses mots cinglants, ceux qui démontent les faibles et ébranlent les robustes. Avec comme bouclier cette générosité propre aux gens entiers, et cet ego surdimensionné propre à… Lui-même, en fait.
Ses fameux mots, pris trop souvent juste pour ce qu’ils sont, sans que beaucoup ne voient ce qu’il a voulu en faire : des mots d’esprit.
Nicolas est drôle, de cette forme d’humour qui attaque l’autre sans sommation, qui percute froidement ceux qu’il aime un peu moins, qui se cache derrière une arrogance à la limite du tolérable. Qui finalement lui forge l’armure qui le rend prêt à affronter ce monde sans pitié, ce monde où les fils de n’ont pas toujours le droit d’avoir un prénom.
Nicolas Bedos est ce qu’il est, avec son talent et ses failles, son héritage et son génie propre.
Si l’homme est un grand enfant, Nicolas est un éternel petit garçon, attendrissant et capricieux.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 26 Octobre 2013 à 20:11
Mon meilleur ami, je le connais depuis presque quinze ans. Il est rock ‘n roll, gracile parfois, acide trop souvent, gentil la plupart du temps. Il ressemble à Frédéric Lopez. Il est homo mais aime les gros seins (je crois que c’est en partie pour ça qu’on est amis d’ailleurs…), il aime quand je lui fais à manger. Il aime appuyer là où ça fait mal. Il dessine, divinement bien, il est fort pour ça.
Je lui ai fait peur une fois, en négociant (un peu trop à son goût) le prix au marché noir des places d’un concert complet de Tori Amos. Lui me ridiculise depuis des années en racontant partout l’anecdote relative à notre rencontre, une histoire d’avances avortées par l’annonce de son homosexualité… On rigole bien tous les deux. Enfin, on rigolait bien. Car depuis quelques temps, on rigole moins. L’acidité prend le dessus. L’ennui, aussi, souvent, je le vois bien. Je sais qu’il ne va pas très fort. Lui, il ne me dit rien. Il prend les mauvaises décisions, fait les mauvais choix. Jusqu’ici tout ça ne me concernait que de loin, alors je gardais le sourire et espérais que tout ça s’arrange. Pendant ce temps, son comportement commence à faire fuir les autres. Les amis communs, qui eux sont directement concernés par ses écarts de conduite, et qui en ont soupé de lui faire la leçon et de faire des efforts en vain.
J’ai une meilleure amie, aussi. Elle nous est commune. Elle est précieuse. Comme les autres, mais elle a l’avantage de l’antériorité. N’habitant pas tous dans la même ville, nous n’avons pas la possibilité de nous voir à volonté. Alors on se réjouit des rendez-vous annuels que nous imposent à chacun le passage d’une année à l’autre, rituels qu’on essaie de ne pas manquer.
Pourtant un soir, sous un prétexte fallacieux, monsieur mon ami décide d’abandonner son rituel à elle. Blasée, elle n’en fait pas une montagne. Elle n’est plus surprise. Elle en rigole, même.
Moi, pour la première fois je suis en partie concernée et la colère monte du fond de mes tripes. Ca ne se passera pas comme ça. Pas un culot pareil, pas un tel manque de respect. Echange de sms, irritation, braquage. Rupture.
Depuis ce soir-là, mon cœur est serré. Mon cœur est serré parce que moi, j’ai du mal à faire sans lui. Il me manque un bout d’amitié. Je voudrais tant que tout redevienne comme avant… Mais pour ça, il faudrait qu’il en ait envie. Il faudrait qu’il se détende. Il faudrait qu’il crache ce qu’il a sur le cœur, qu’il vide son sac et appelle au secours. Les amis, les vrais, c’est de l’amour fraternel mais c’est aussi les oreilles qui vont avec. On peut trouver des solutions. On peut motiver, soutenir, empêcher. Mais il faut parler. Il faut dire si on ne veut plus, il faut dire si on veut plus. Ne pas faire semblant. Ne pas avoir l’air de dénigrer les autres, ne pas croire que certains choix de vie empêchent le bon déroulement de l’amitié. Profiter du moment et des gens présents. Ne pas croire que l’herbe sera plus verte à côté, ce n’est jamais vraiment vrai. Assumer ce que l’on est. Tout ça n’empêche pas de rêver, hein.
« Quand je serai grand, je vivrai avec un artiste hype dans un apart atypique en plein cœur d’un quartier bobo »
« Quand je serai grand, mes amies ne seront pas des ménagères de moins de cinquante ans, mères de famille dans un HLM »
« Quand je serai grand, ma vie sera parfaite »
Les rêves nourrissent la vie, et la vraie vie permet les rêves. Il faut juste la comprendre, l’accepter, la digérer et l’apprécier. Et profiter de ce qu’elle nous offre de bon.
Reviens, tu seras toujours mon ami tu sais. Enfin, si tu décides de le rester…
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Cinnamon Fraise le 3 Octobre 2013 à 11:16Le débat sur le Mariage pour tous, moi, ça me rappelle un certain film avec Jean Carmet, "La Controverse de Valladolid" : Au XVIe siècle, soixante ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, règne sur l’Espagne Charles Quint qui convoque une assemblée sous l’égide du légat pontifical, afin de débattre de la question fondamentale : les indigènes indiens, dont elle a colonisé les territoires en Amérique, ont-ils une âme (sont-ils des hommes) ? (De la réponse doit découler l'arrêt ou non de l’esclavage dont ils sont alors les victimes). (source Wikipédia)
->Les homosexuels ont-ils le droit d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, voilà la question de 2013.
Moi je suis répugnée à l'idée que ce débat déclenche une "guerre civile" (selon Mme Boutin), et mobilise autant de gens qui descendent dans la rue pour cela. A quand une même hargne contre la fausse liberté dont jouit l'homme sur cette planète ? A quand une même hargne contre les débilités avilissantes dont la télé abreuve le jeunesse d'aujourd'hui, les adultes de demain ? A quand une même hargne contre le gavage financier intensif des "hauts-placés", grands patrons ou politiques ? A quand une même hargne contre la pourriture infiltrée entre chaque couche de lasagne industrielle ? A quand une même hargne contre la destruction consciente de notre planète ? A quand une même hargne contre les "obligations professionnelles" engendrant délocalisations familiales et autres heures perdues chaque jour dans les transports en commun ? Il n'y a pas de petit combat, il n'y a que des combats justes. Et celui-ci ne l'est pas. Non mais Allo, quoi. votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique